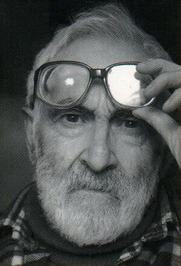 Un écrivain slave est par définition un poète. Il ne l’est pas à la manière des artistes romantiques d’Occident, mais à la manière du sage qui veille sur les siens et questionne le ciel. En lisant Un moustique dans la ville, on imagine facilement Erlom Akhvlediani au sommet d’une colline géorgienne, apostrophant Dieu pour comprendre l’Homme. L’écrivain slave est un poète et, par extension, un philosophe.
Un écrivain slave est par définition un poète. Il ne l’est pas à la manière des artistes romantiques d’Occident, mais à la manière du sage qui veille sur les siens et questionne le ciel. En lisant Un moustique dans la ville, on imagine facilement Erlom Akhvlediani au sommet d’une colline géorgienne, apostrophant Dieu pour comprendre l’Homme. L’écrivain slave est un poète et, par extension, un philosophe.
Pourquoi ouvrir ce livre ? On s’attend sans doute à suivre la plume d’un artiste tourmenté, suivre les chants slaves à la façon de Kusturica, voyager à travers les paysages orientaux. Et en effet, l’on voit des matsoni (yaourt) et des tkémali (arbre). Mais ce n’est pas la finalité d’Akhvlediani, qui met la poésie au service de ses interrogations métaphysiques. On entre immédiatement dans son monde, on regarde par son prisme. Pourquoi le ciel est-il d’azur ? questionne le narrateur dès les premières lignes. Il n’y a rien de naïf, ni rien d’absurde, dans l’écriture du Géorgien. Tout paraît extravagant ou fou, mais c’est une folie dosée au compte-goutte qui emporte le lecteur dans un monde où la nature juge l’Homme, et non le contraire.
La sensibilité de l’âme slave
Les personnages tentent de comprendre ce qui les entoure. Tout est bizarre, tout est impénétrable. La lune est chose bizarre. Tantôt elle erre, çà et là, comme une mendiante, tantôt elle stupéfie l’univers entier par sa majesté royale. Fasciné, l’Homme est un poète condamné à ne pas savoir. Tout le monde est traversé par cette force ignorée. En dévoilant sciemment le cheminement de sa réflexion et de son œuvre, l’auteur veut que le lecteur devienne poète, se sente perdu dans cette nature immense et incompréhensible.
Ce n’est pas l’Homme qui comprend, c’est la nature. Ce n’est donc pas étonnant de constater que le plus beau chapitre de ce livre, s’il fallait en trouver un, soit celui où l’on suit les péripéties d’une pierre, d’un joli petit caillou qui trouve la clé de la vie dans l’amour d’un semblable. En sortant de ce chapitre, l’expression avoir un cœur de pierre change brutalement de sens. Akhvlediani a donné au minéral une âme douce et légère. Et pourquoi pas ?
Un auteur original
On croirait lire un auteur russe. Erlom Akhvlediani a obtenu grâce à ce livre des distinctions nationales. Il varie sans se soucier de la cohérence littéraire. Il laisse se promener ses mots d’une description narrative à une réflexion triviale, d’un discours tolstoïen à une digression déroutante. Si les premiers contacts avec le monde fantasque de l’écrivain surprennent le lecteur, ils ne le transforment pas moins. Je crois que si la fumée d’une cigarette était aussi transparente que l’air, personne ne fumerait de cigarette, affirme son double, narrateur. Et l’on se dit : il a raison, diantre ! Mais que vient faire cette phrase ici ? La seule réponse qui nous vient à l’esprit est : c’est la poésie slave. C’est cela que l’on aime et c’est pour cela que Moustique dans la ville fonctionne à merveille.
Le talentueux Géorgien vend plus mal son livre qu’il ne l’a écrit. Qui a-t-on vu écrire, à la fin même de sa création : Je suis faible en orthographe et surtout en ponctuation, sans parler de la composition de l’œuvre, du style, de la faculté de conter, de la précision, de la profondeur ou de l’élan des émotions exprimées ? On croirait entendre Dostoïevski maudire les limites de son talent. Pourtant, à l’instar d’un Otar Iosseliani, Akhvlediani sait construire une œuvre et transmettre un message subliminal.
Analyse
Il nous reste à trouver ce message, limpide mais diffus dans chaque ligne.
Le héros est un moustique, un insecte, une étrange pensée de la nature. Le moustique sait où il va et ce qu’il veut ; la mort. L’Homme, lui, erre et se promène. On ressent à travers le livre l’admiration de son auteur pour la seule forme de vie valable, celle qui est mue par l’amour. Ce qui, dans la vie, n’est pas amour, n’est que mort. La vie et la mort sont une seule et même chose, dira le moustique. Que symbolise cette bête ? Je suis ton moustique, ta faiblesse et ton impuissance, dit-il, vague.
On se demande ce qui retient le personnage, Djimchère, de mettre une bonne claque au moustique et mettre fin à ses jours. C’est que l’on ne peut se défaire de ce moustique, cette faiblesse. Sans elle, ce n’est déjà plus la vie… Quelle peut être cette faiblesse ? Sans doute l’amour, qui fait de Djimchère un être humain. Et c’est l’amour, talon d’Achille, qui tuera les humains.
Dans cette hypothèse, le moustique a les yeux bleus et ainsi voit le ciel d’azur. Ce qui expliquerait la question initiale et la réponse à toute les questions de l’auteur : c’est par le prisme de l’amour que l’Homme vit, voit le monde et meurt.
Paul LEBOULANGER





